Ce qui devait arriver est arrivé : la multipolarité géopolitique issue de la fin de la Guerre froide tourne à l’affrontement des grandes puissances. L’antagonisme n’est heureusement qu’industriel. Dans cet environnement, la neutralité économique apparaît comme la seule attitude raisonnable des petits Etats très exportateurs à l’échelle planétaire. La Suisse devrait mieux en tenir compte dans sa politique européenne.
Dans les années qui ont suivi la fin de la Guerre froide, un large consensus intellectuel affirmait que le monde allait progressivement passer d’un état de bipolarité géopolitique à une configuration multipolaire. Cinq pôles étaient en général mentionnés. Ils correspondaient en gros aux plus grandes puissances démographiques, politiques et économiques: les Etats-Unis, l’Union Européenne, la Russie, l’Inde et la Chine (l’Inde a disparu de ce panthéon par la suite). Le monde s’étant débarrassé des guerres impériales et totales, la signification de cette nouvelle multipolarité semblait surtout économique.
La période était d’ailleurs dominée par l’idéologie multilatéraliste anglo-américaine. Cette doctrine d’inspiration éco-wilsonienne allait culminer dans l’Organisation mondiale du commerce, créée en 1995. Un idéal pacifiste diffus imprégnait la multipolarisation du multilatéralisme universel. Depuis la Belle Epoque en Europe, au début du XXe, jamais la conviction très libérale que les échanges internationaux rendaient la guerre impossible n’avait semblé aussi naturelle. La menace nucléaire achevait d’en faire une vérité définitive.
Tout s’est passé comme si les courants intellectuels, littéraires et politiques de l’après-Guerre froide avaient oublié que la notion même de superpuissance incluait celle de rivalité. On ne se rendait pas bien compte non plus à quel point l’économie allait devenir un substitut de la guerre dans l’antagonisme des grandes souverainetés. L’idée que les Etats leaders du nouveau et paisible monde multipolaire interdépendant étaient voués à s’affronter était tout simplement absente des débats. Ce genre de prémonition n’a laissé aucune trace intelligible pendant au moins dix ans. Il en a fallu vingt pour se rende compte que le destin de l’Europe et de l’Amérique avait lui-même cessé d’être commun.
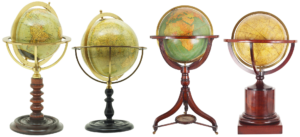 L’arme des grands marchés
L’arme des grands marchés
C’est l’émergence de la Chine et de l’Union Européenne, mâtinée d’un anti-américanisme opérant comme le plus petit dénominateur commun, qui a progressivement réveillé les consciences. Ne parlons pas d’impérialisme, moins encore de néo-impérialisme, des termes surchargés de connotations vaines et contradictoires. Le monde du XXIe siècle naissant se reconnaît plutôt dans la simple collision de quatre hégémonies économiques. Trois au moins manient l’arme de leur vaste et incontournable potentiel de consommation et de production.
La première spécificité des Etats-Unis, de l’Union Européenne et de la Chine n’est pas seulement que leur immense marché intérieur permet de réduire leur dépendance par rapport au monde (ce qui représente un fond de souveraineté considérable). Elle se trouve aussi dans le fait qu’aucune activité globale, en particulier technologique ou de marque, ne peut se passer d’accès à ces larges et intenses bassins de clientèle privée et institutionnelle.
Les grands Etats ont un faible ratio de commerce extérieur par rapport à leur création annuelle de valeur (trade-to-GDP ratio). Pour le dire plus simplement, leur prospérité de long terme dépend peu des exportations et importations (moins de 10% aux Etats-Unis). Elle équivaut en général à la vigueur de leur marché intérieur. Après avoir favorisé le développement de l’économie globale, les Etats-Unis, l’Union Européenne et la Chine sont entrés dans une phase de recentrage sur leur marché intérieur.
L’accès au marché s’est en ce sens substitué
aux politiques coloniales de la canonnière.
Cette quête autarcique ne sera évidemment jamais complète. Elle passe néanmoins par un regain de protectionnisme revêtant des formes assez diverses : relèvement archaïque des barrières douanières, politiques fiscales dissuasives, taxation et renchérissement des transports, densification des normes écologiques et de qualité, contrôle des fusions, acquisitions et investissements directs, multiplication des aides et financements publics d’intérêt national, etc. Sans parler des listes noires et des embargos. Ils n’avaient jamais vraiment disparu non plus. Ni des contreparties non économiques exigées en échange de nouvelles facilités d’accès aux grands marchés. Elles sont souvent liées à des problématiques nationalistes de voisinage. Comme dans le cas de l’Union Européenne avec la Suisse, des Etats-Unis avec le Mexique, ou de la Chine avec Taiwan. L’accès au marché s’est en ce sens substitué aux politiques coloniales de la canonnière.

Multilatéralisme universel
A contrario, la mentalité économique des Etats à démographie restreinte relève en général d’un haut degré de mercantilisme au sens classique du terme : la prospérité vient en premier lieu de la capacité à exporter (compétitivité), qui permet ensuite d’importer ce que l’on ne peut pas – ou ne veut pas – produire soi-même. Ce besoin d’ouverture crée des rapports de dépendance rendant en général les questions de souveraineté plus compliquées et plus exigeantes. Même si la sagesse populaire selon laquelle on a toujours besoin d’un plus petit que soi se vérifie souvent, les grands Etats peuvent se passer d’un nabot qui ne leur revient pas. L’inverse est une autre histoire.
Il n’est pas étonnant que les petits Etats défendent en général un multilatéralisme basé sur l’égalité des nations (au sens anglophone d’Etat). Il peut s’agir d’un multilatéralisme régional, genre zone de libre échange ou marché commun, consacrant la relation de dépendance pour l’approfondir (Union Européenne). Ou de multilatéralisme global, à l’image de ce que l’OMC a réalisé. L’objectif de souveraineté des petits Etats est en général d’élargir les partenariats, pour dépendre le moins possible de chacun d’eux. C’est ce à quoi les membres secondaires de l’UE ont renoncé avec l’Union douanière.
Le multilatéralisme global égalitaire n’avait pas atteint sa pleine maturité que la futurologie des années 1990 aimait déjà thématiser la formation de grandes zones économiques macro-régionales. L’émergence euphorique du Marché unique en Europe, autour de l’axe franco-allemand, attisait les scénarios de long terme sur de futurs partenariats panaméricains, euro-africains et sino-asiatiques de proximité (macro-régionalisme). La notion de confrontation des superpuissances étant absente, celles d’exclusivité et de loyauté de la part de leurs satellites ne l’étaient pas moins. Ce n’était pas encore un problème.

Fin de l’innocence
Cette innocence toute libérale s’est assez vite dissipée dans ce qu’il faut bien appeler le retour des politiques de puissance, d’obédience et de clientélisme appliquées au domaine industriel. Pour s’en tenir aux plus grands symboles de l’actualité, prenons une compagnie britannique de moyens courriers comme Easyjet. Elle opère essentiellement en Europe. On la verrait mal s’équiper en Boeings juste après le Brexit, et obtenir néanmoins des égalités de traitement avec les compagnies continentales sur l’exploitation des lignes aériennes.
On n’imagine pas les Suisses opter pour des avions de combat américains par rapport à leurs problèmes continuels de voisinage avec l’Union Européenne. L’acquisition idéale serait un Rafale pour apaiser la France, inspiratrice et cheffe de file des suissophobes en Europe. Le groupe chinois de technologies Huawei est ostensiblement discriminé aux Etats-Unis et en Europe. Bruxelles et des Etats membres font tout pour entraver et décourager les grands groupes américains de l’internet. La Chine, qui s’était relativement ouverte, n’a plus du tout la même motivation. Son trade-to-GDP ratio est passé de 60% à 30% en dix ans. Elle préfère investir aujourd’hui dans le monde plutôt que vendre à l’étranger. Il est devenu banal de se plaindre ou de se réjouir partout des tendances de plus en plus protectionnistes, alors que le protectionnisme passait depuis des décennies pour une relique barbare hors-sujet.

Concurrence déloyale
La phase protectionniste dans laquelle la civilisation industrielle s’est engagée n’est évidemment pas favorable aux puissances « moyennes » peu enclines à cultiver la mono-dépendance (ou mono-interdépendance, ce qui revient au même sous cet angle). Les grands ont d’ailleurs peu d’états d’âme par rapport à ces quantités géopolitiques négligeables, fanfaronnant si souvent en tête des classements de performances économiques.
Ne sont-ils pas surtout des profiteurs bénéficiant de coûts de complexité bien moins élevés sur le plan des conditions cadres ? S’ils développent en plus des relations privilégiées avec de grands rivaux genre Union Européenne, à quoi bon les reconnaître pleinement en tant qu’Etats? Les assimiler à leur protecteur ne semblerait-il pas plus cohérent? On se souvient du drame que provoqua en Suisse la non-invitation au G20 de crise en 2008. Une véritable humiliation pour la quatrième place financière du monde, la dixième puissance économique (l’UE comptant pour une) et le septième exportateur en chiffres absolus (l’Europe comptant pour vingt-huit).
Cette méfiance est précisément celle de l’Europe franco-allemande par rapport au Royaume-Uni, à sa proximité et à ses affinités avec l’économie américaine (voire chinoise ou indienne). Les Britanniques qui ont voulu désimbriquer leur pays de l’Union Européenne savent pourtant ce que neutralité économique veut dire. Leur objectif n’est absolument pas de rejoindre l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA). C’est au contraire de pouvoir ajouter au multilatéralisme global de l’OMC des accords bilatéraux ou régionaux diversifiés à l’échelle du monde. Sans apparaître comme de simples affiliés. C’est ce que leur appartenance à l’Union douanière européenne les a empêchés de faire pendant des décennies. Alors que la libre circulation des personnes les contraignait à accorder aux Européens un accès privilégié au marché britannique du travail.
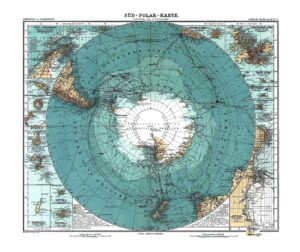
Communauté de destins
La plupart des économies nationales ouvertes ont un commerce extérieur à dominante macro-régionale. C’est a fortiori le cas des pays de l’Union européenne (c’est d’ailleurs l’une de ses finalités) : leurs exportations se dirigent vers les autres Etats membres. A plus de 70% dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou de l’Autriche. A près de 60% en Allemagne, en France ou en Suède (Eurostat 2018). Ce n’est en revanche plus le cas du Royaume-Uni depuis des années. Ses exportations intra-européennes sont devenues minoritaires. Elles ne représentent plus que 45% des ventes à l’étranger. Soit une diminution de 10 points de base sur 20 ans (comme en Suisse), alors que le périmètre de l’Union s’est agrandi.
La Suisse connaît également un élargissement continu de son commerce extérieur depuis les années 1990. Les ventes à destination de l’Union européenne seront bientôt minoritaires elles aussi dans les exportations. Elles ne sont plus que de 52%, alors qu’elles dépassaient encore 60% de l’ensemble il y a vingt ans (64% en 2001). Elles se rapprocheront des 45% après la réalisation du Brexit (le Royaume-Uni et la Suisse seront les deux seuls Etats d’Europe à exporter davantage dans le monde que sur le continent).
Cette globalisation croissante a d’abord l’avantage de diversifier les risques conjoncturels géographiques. Elle permet surtout de bénéficier des taux de croissance élevés en Amérique et dans les grandes régions en développement, plutôt que de subir les problèmes structurels chroniques pesant sur l’Europe. Elle a eu lieu jusqu’ici dans un environnement monétaire tendanciellement défavorable, incitant continuellement l’industrie à se concentrer sur des spécialités sophistiquées et à marges élevées, dont le marché ne peut être que mondial.
On comprend dès lors que la politique économique de la Suisse proclame son attachement au multilatéralisme global plutôt que régional. L’OMC et d’autres agences économiques internationales ne sont-elles pas en plus basées à Genève ? Certaines attitudes découlent naturellement de ce genre de privilège historique.

Bon sens commercial
Le multilatéralisme universel ne progresse plus. Il régresse même par endroits, mais il n’a pas rendu l’âme. La plupart de ses acquis les plus importants vont probablement survivre à la phase protectionniste actuelle. Pour repartir peut-être sur de nouvelles bases, pour un nouveau cycle. Lorsque les ajustements macro-économiques nécessaires auront été réalisés (rééquilibrage partiel des balances commerciales en particulier).
En attendant que le terme redevienne audible, le multilatéralisme en suspension a une signification évidente pour les économies nationales les plus globalisées (et qui veulent le rester) : la neutralité économique. Elle fait partie du plus élémentaire bon sens commercial : ne pas accepter de privilèges qui obligent. Ne pas se lier à des clients en concurrence avec d’autres. Respecter le principe d’égalité de traitement. Sur le plan de la politique économique : appliquer la clause de la nation la plus favorisée. Si le libre accès des Européens au marché suisse du travail est considéré comme une liberté économique, alors l’accorder à tous les autres. En commençant par les Américains, les Chinois, les Indiens… Ou alors s’abstenir.
La neutralité économique n’est pas un absolu.
Juste un principe à faire valoir dans l’intérêt de tous à long terme
La neutralité économique n’empêche nullement de faire partie de zones de libre-échange régionales classiques et non exclusives, comme il en existe plusieurs qui se recoupent en Asie. La neutralité économique n’est pas un absolu. Juste un principe à faire valoir dans l’intérêt de tous à long terme. A part la Suisse et le Royaume-Uni, on pense spontanément à ce que cette valeur d’indépendance peut représenter pour des Etats comme le Japon, la Corée, Taiwan, Israël, Singapour, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. Mais il y en a bien d’autres. Des Etats continuellement soucieux de ne pas apparaître comme des fournisseurs privilégiés ou clients captifs d’une grande puissance hégémonique.

La valse des malentendus
Dans les semaines qui ont précédé et suivi le Brexit, un courant d’opinion peu renseigné avait fait de la Suisse le modèle susceptible d’inspirer le Royaume-Uni pour ses futures relations avec l’Union Européenne. Un article particulièrement enlevé du Financial Times avait coupé court à ces spéculations. La Suisse, fut-il rappelé avec un mépris plutôt paradoxal venant d’un média historiquement européiste, n’est-elle pas au contraire un modèle d’Etat intégré progressivement à l’Union Européenne ?
Passe encore qu’elle ait adhéré aux Accords de Schengen et Dublin, que les Britanniques ont toujours rejetés. Mais la Suisse n’a-t-elle pas aussi accepté la libre circulation des salariés et indépendants, dont le Royaume vient précisément de se débarrasser ? Avec des approfondissements en cours de négociation dans le cadre d’un accord institutionnel, comprenant des reprises automatiques du droit communautaire ? Tout ce dont les Britanniques du Brexit ne veulent plus entendre parler.
Cette image d’une Suisse inféodée à l’Europe de Bruxelles est en fait celle qui circule aujourd’hui dans les milieux économiques des cinq continents. Les Suisses ne donnent guère l’impression d’être en mesure actuellement de préserver leur neutralité économique. Leurs spécificités semblent plutôt vouées à se dissoudre dans l’homogénéité du marché européen. Leur image condamnée à devenir de plus en plus européenne au sens le plus controversé et le plus décevant du terme*. A moins qu’ils acceptent enfin la confrontation avec l’Union, lorsque leurs organisations économiques auront compris où se trouvent les intérêts les plus durables de la place industrielle, de services, de recherche et de développement. Investir dans l’avenir de la Suisse, c’est d’abord investir dans sa neutralité économique. Ce n’est pas d’abord une question d’argent, mais bien de volonté. De volonté populaire plus précisément.
Revue de presse commentée https://cutt.ly/ve5wzDI
*Annexe
Décrochage industriel européen
« Un seul fait suffit pour se convaincre du décrochage industriel de l’Europe: en 2008, sur les 500 premières entreprises mondiales, 171 étaient européennes et 28 chinoises ; dix ans plus tard, 122 sont européennes et 110 chinoises. Dans le secteur numérique, les Américains ont leurs GAFAM ; les Chinois leurs BAT (Baidu, Alibaba, Tencent); les Européens, eux, n’ont pas réussi à faire émerger une seule entreprise de cette envergure.
Face à ce sentiment de déclin, l’Europe, par la voix notamment de la France et de l’Allemagne, a cru trouver dans la politique de concurrence la cause principale de ses maux. À la suite de l’interdiction de la fusion Alstom – Siemens, le contrôle des concentrations a été montré du doigt: trop rigide, trop centré sur le seul intérêt des consommateurs, il empêcherait l’émergence de nouveaux géants sur notre continent.
Or cette explication apparaît peu fondée. Les statistiques ne confirment pas la prétendue intransigeance de la Commission par rapport à ses homologues américains, bien au contraire: sur la période 2014-2018, seules trois opérations ont été interdites par la Commission dans l’Union européenne, alors que le Department of Justice et la Federal Trade Commission ont tenté d’en faire annuler vingt-deux aux États-Unis. Il est certes nécessaire d’améliorer le contrôle des concentrations, par une réelle prise en compte des gains d’efficacité ou une vigilance accrue face aux «acquisitions tueuses» ; mais l’affaiblir serait un contresens. »
Emmanuel Combe, Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, extrait de « Renforçons enfin la défense commerciale de l’Europe face aux États-Unis et à la Chine! » Figaro Vox, 5 décembre 2019. Les trois auteurs viennent de publier une étude en trois volumes : L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (Fondapol, « think tank libéral, progressiste et européen »).
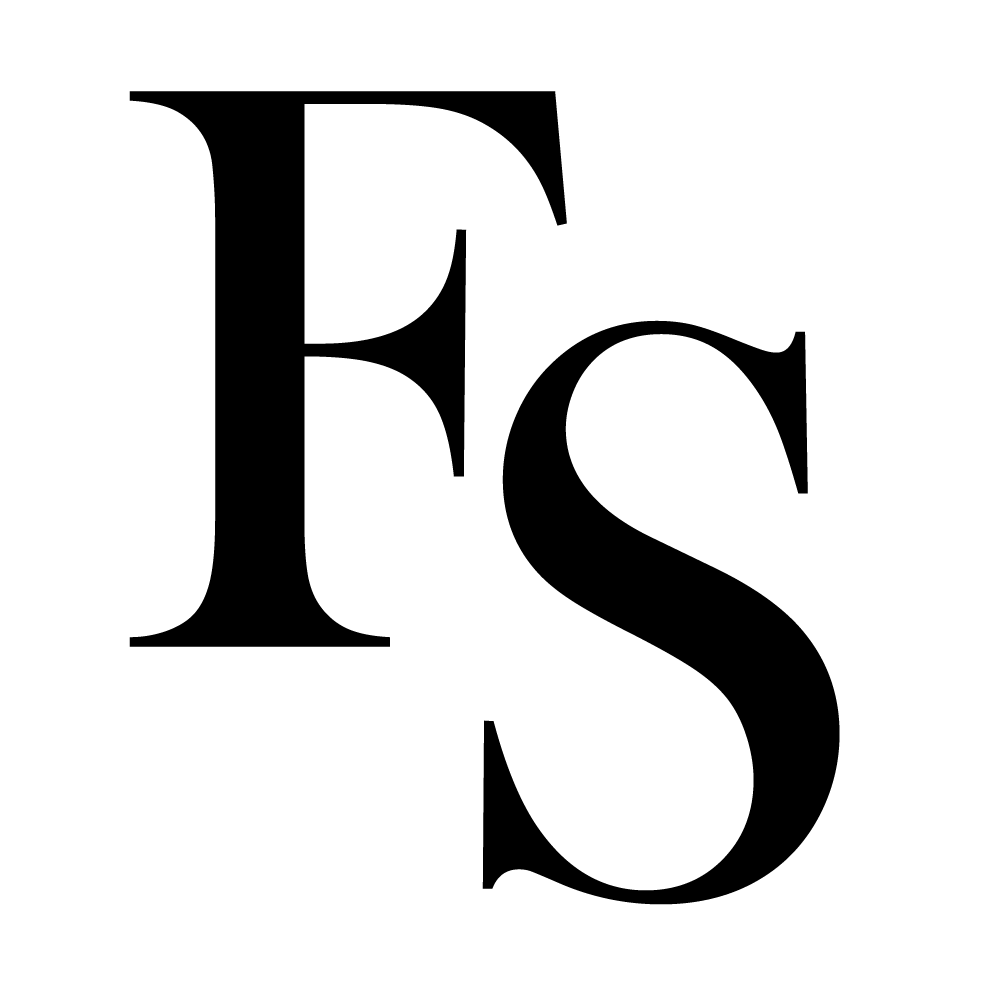
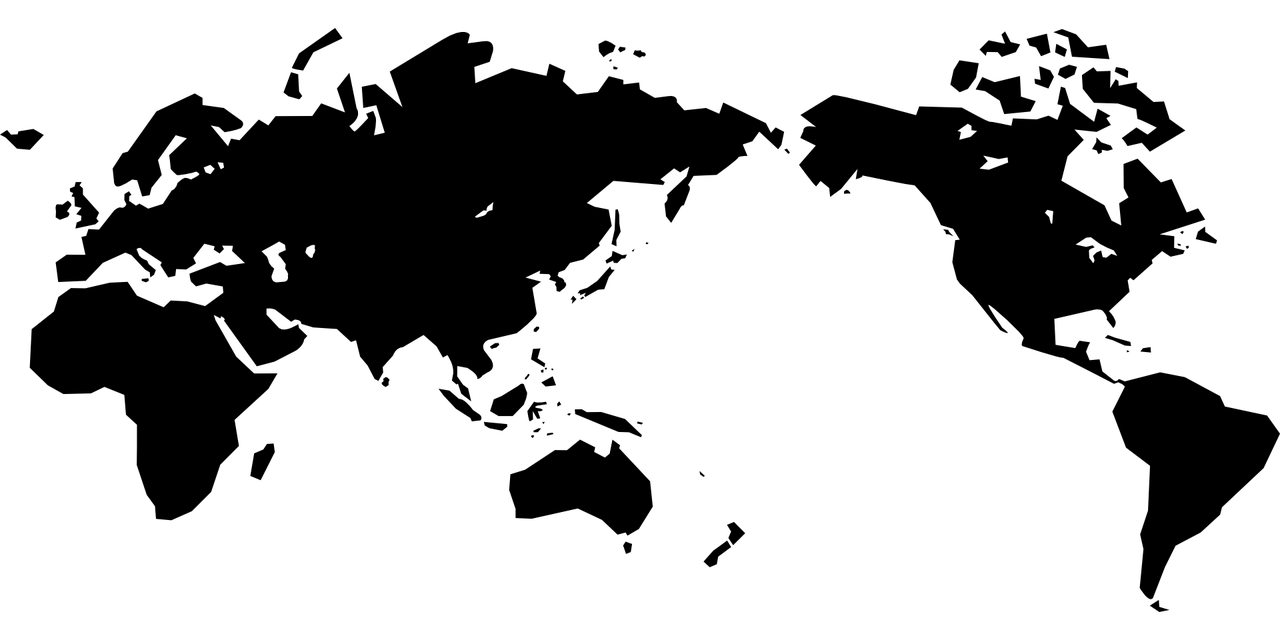

Pour les Rafales vous avez raison mais il s’agit pour la Suisse d’un projet de long terme or la France n’est plus un pays stable ni politiquement ni économiquement. La France a vendu 2 porte-hélicoptères à la Russie qu’elle n’a jamais livrés et la haine du Président Macron de la Suisse n’a de comparable que celle de M. Sarkosy. M. Macron veut se rapprocher de la Russie et maintenant il se met l’Otan sur le dos !!!
A chaque achat de pièce de rechange pour les Rafales ils viendront marchander pour autre chose, la Suisse a eu une pénible expérience avec les Mirages et un chat échaudé craint l’eau froide.
Pour les Rafales vous avez raison mais il s’agit pour la Suisse d’un projet de long terme or la France n’est plus un pays stable ni politiquement ni économiquement. La France a vendu 2 porte-hélicoptères à la Russie qu’elle n’a jamais livrés et la haine du Président Macron de la Suisse n’a de comparable que celle de M. Sarkosy. M. Macron veut se rapprocher de la Russie et maintenant il se met l’Otan sur le dos !!!
A chaque achat de pièce de rechange pour les Rafales ils viendront marchander pour autre chose, la Suisse a eu une pénible expérience avec les Mirages et un chat échaudé craint l’eau froide.
La neutralité économique est un bien beau concept, mais elle semble faire fi de la géographie.
La Suisse est un petit pays sans accès à la mer, entièrement entourée par l’Union Européenne. Reléguer l’UE au même rang qu’un partenaire économique à l’autre bout du monde semble utopiste, au minimum pour des raisons de logistique.
Il me semble que diversifier les partenaires est en effet un point primordial; mais il ne faut pas se voiler la face, notre pays est et restera à la merci de l’UE, l’histoire et la géographie en ont voulu ainsi.
“L’antagonisme n’est heureusement qu’industriel.”
Vous n’avez rien compris au monde “moderne” ou vous faites semblant?
“L’antagonisme n’est heureusement qu’industriel.”
Vous n’avez rien compris au monde “moderne” ou vous faites semblant?
D’accord avec vous pour l’essentiel, sauf pour les achats d’avions. La Suisse achètera du matériel américain..
D’accord avec vous pour l’essentiel, sauf pour les achats d’avions. La Suisse achètera du matériel américain..
La neutralité économique est évidemment conforme aux intérêts de la Suisse. Elle l’a toujours été. Mais ceci ne nous oblige pas à conserver l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le peuple avait accepté cet accord, mais s’étant aperçu qu’on lui avait menti en lui disant qu’il ne provoquerait pas d’immigration massive, il est revenu sur son choix et à voté contre le 9 février 2014. La classe politique s’étant assise sur cette décision du souverain et ayant, pour ne pas l’appliquer, violé la constitution sur ordre de Bruxelles, le peuple aura de nouveau l’occasion bientôt de revoter (initiative UDC dite Begrenzungsinitiative). On verra bien ce qui sortira de cette votation. Le chantage à Schengen a peut-être suffi pour qu’on accepte d’écorner les droits du citoyen soldat à posséder son arme. Mais quand il s’agira de protéger les travailleurs suisses du dumping social, le resultat pourrait être different.
À part ça, nous devons être très attentifs au danger du moralisme politiquement correct qui se met déjà au service de l’hégémon américain en demandant que la Suisse résilie son accord de libre échange avec la Chine pour des raisons morales (référence faite à la campagne mondiale anti chinoise qui focalise sur le Sinkiang). Dans ces blogs même, une certaine Isolda Agazzi prêche la suspension de cet accord, donc le boycott de la Chine au détriment des places de travail en Suisse, entonnant les trompettes de la déclaration de Berne. Heureusement il y a peu de chance pour que notre pays très sinophile suive ces billevesées. Mais c’est tout de même choquant de lire ces propos de soumission à l’impérialisme yankee. Max Petitpierre doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait eu ce coup de génie de reconnaître la RPC en 1950.
En revanche, une bonne chose qu’on pourrait faire, serait de réhabiliter le secret bancaire fiscal, puisque nos amis de l’Union Europeenne refuseront toujours d’accorder à la Suisse un level play field dans le domaine financier. Il serait effectivement temps de perdre cette “innocence” béate et stupide et de se rappeler que notre pays a des intérêts et des concurrents. Pourquoi toujours vouloir que la Suisse soit bien vue? Le jour où elle sera bien vue dans les grandes capitales, c’est qu’elle aura cessé d’exister.
La neutralité économique est évidemment conforme aux intérêts de la Suisse. Elle l’a toujours été. Mais ceci ne nous oblige pas à conserver l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le peuple avait accepté cet accord, mais s’étant aperçu qu’on lui avait menti en lui disant qu’il ne provoquerait pas d’immigration massive, il est revenu sur son choix et à voté contre le 9 février 2014. La classe politique s’étant assise sur cette décision du souverain et ayant, pour ne pas l’appliquer, violé la constitution sur ordre de Bruxelles, le peuple aura de nouveau l’occasion bientôt de revoter (initiative UDC dite Begrenzungsinitiative). On verra bien ce qui sortira de cette votation. Le chantage à Schengen a peut-être suffi pour qu’on accepte d’écorner les droits du citoyen soldat à posséder son arme. Mais quand il s’agira de protéger les travailleurs suisses du dumping social, le resultat pourrait être different.
À part ça, nous devons être très attentifs au danger du moralisme politiquement correct qui se met déjà au service de l’hégémon américain en demandant que la Suisse résilie son accord de libre échange avec la Chine pour des raisons morales (référence faite à la campagne mondiale anti chinoise qui focalise sur le Sinkiang). Dans ces blogs même, une certaine Isolda Agazzi prêche la suspension de cet accord, donc le boycott de la Chine au détriment des places de travail en Suisse, entonnant les trompettes de la déclaration de Berne. Heureusement il y a peu de chance pour que notre pays très sinophile suive ces billevesées. Mais c’est tout de même choquant de lire ces propos de soumission à l’impérialisme yankee. Max Petitpierre doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait eu ce coup de génie de reconnaître la RPC en 1950.
En revanche, une bonne chose qu’on pourrait faire, serait de réhabiliter le secret bancaire fiscal, puisque nos amis de l’Union Europeenne refuseront toujours d’accorder à la Suisse un level play field dans le domaine financier. Il serait effectivement temps de perdre cette “innocence” béate et stupide et de se rappeler que notre pays a des intérêts et des concurrents. Pourquoi toujours vouloir que la Suisse soit bien vue? Le jour où elle sera bien vue dans les grandes capitales, c’est qu’elle aura cessé d’exister.
Votre concept de neutralité économique est une vision théorique. Or la pratique reposera bien évidemment sur la réalité commerciale et économique qui va être remise en question par le changement climatique en cours. Ce dernier dépend en grande partie de l’activité humaine, n’en déplaise aux artisans de l’illusion de la croissance continue.