S’opposer à l’adhésion de la Suisse à l’Union Européenne depuis trente ans, mais dire oui à tout ce que demande Bruxelles pour ne pas risquer de représailles ? Allez comprendre où peut bien mener cette politique.
L’adhésionnisme des années 1990 : une chimère insensée, mais tout à fait respectable… Les adhésionnistes proclamaient à l’époque que la Suisse était complètement européenne sur le plan géographique, historique, culturel, économique. Qu’elle devait donc s’associer pleinement à l’œuvre européenne de paix, de consolidation et de rayonnement de ses valeurs (surtout héritées des Lumières). Ce romantisme de premier degré s’est raréfié dans les années 2000, mais il n’a pas disparu.
L’Union Européenne s’est ensuite présentée beaucoup plus clairement comme un simple projet de puissance, après des décennies d’intimidations et de chantage à la guerre : « Si vous n’êtes pas européiste, vous serez personnellement responsable du retour des guerres en Europe », s’entendait-on dire en substance. Aujourd’hui, la paix n’est plus guère évoquée dans la justification existentielle de l’UE.
C’est la puissance qui l’emporte. On peut même dire qu’elle est seule à subsister : il est crucial que l’Europe pèse dans les affaires du monde, qu’elle puisse tenir tête à la Chine, aux Etats-Unis, à la Russie, rivaux et ennemis plus ou moins réels ou potentiels, voués à s’affronter. Recyclé tous azimuts, ce vieux leitmotiv de l’anti-péril jaune est devenu la raison d’être de l’Union. Même l’Allemagne et la France prises séparément deviendraient insignifiantes sans la puissance en devenir de l’UE. Les adhésionnistes d’aujourd’hui pensent ainsi qu’en adhérant, les Suisses s’élèveraient à la superpuissance européenne, politique, économique, technologique et bientôt militaire.
De plus en plus minoritaire, cette approche n’en a pas moins traversé toute les crises de crédibilité depuis la fin des années 1980. En faire la critique relève autant du fait que du droit. Les Suisses partagent bien des valeurs avec les Européens, mais apparemment ni la volonté de puissance ni son apologie. Ni par rapport à elle-même sur le plan identitaire : la Suisse s’est historiquement constituée contre les grandes puissances européennes. Ni surtout par rapport à 136 autres Etats et à leurs ressortissants: la Suisse symbolise dans le monde la possibilité et l’espérance de succès ne reposant précisément pas sur la puissance démographique et politique. Pouvoir prospérer sans devoir se soumettre aux grandes puissances, ne devrait-ce pas relever d’une sorte de droit naturel ? Il s’agit sans doute d’un idéal inatteignable dans son intégralité, mais s’en rapprocher devrait faire partie de la bienséance géostratégique la plus élémentaire. Y renoncer équivaut sous cet angle à une sorte d’abdication.
 L’idolâtrie des rapports de force
L’idolâtrie des rapports de force
Les soumissionnistes, eux, ne s’intéressent guère à ces questions de contenu historique, politique et philosophique. D’autant moins que la perception commune de l’Union Européenne ne parvient pas à se placer au-dessus d’une rhétorique triviale de double exclusion qui la rend insaisissable : jugée bien trop à droite (antisociale) par la gauche, et bien trop à gauche (technocratique) par la droite. Alors seuls comptent les rapports de force. Tout se passe même comme si c’était simplement sur le plan des gains escomptés, de paix et de tranquillité en particulier, qu’il s’agissait actuellement pour la Suisse de se déterminer.
Les soumissionnistes d’aujourd’hui peuvent avoir été les adhésionnistes d’hier. Certains n’ont d’ailleurs pas renoncé à leur idéal. D’autres se comportent comme de simples soumissionnistes. C’est le cas des organisations économiques en Suisse. Alors qu’elles n’ont jamais soutenu l’adhésion, ce qui représente tout de même une belle exception à l’échelle européenne, elles considèrent paradoxalement le rapport de force avec l’Union Européenne comme une fatalité à laquelle il est inutile de s’opposer.
Les moments fondateurs de cette tendance à l’abdication remontent aujourd’hui à trois décennies. Dans un article du 2 décembre 1989 intitulé « Partenaires inégaux », alors que l’Union soviétique s’évaporait et que l’axe franco-allemand élargi à la Communauté économique européenne (CEE) se positionnait comme nouvelle superpuissance de substitution, The Economist fixait en un condensé resté célèbre le nouveau paradigme européen s’agissant de l’Association européenne de libre-échange (AELE, dont la Suisse faisait partie) : c’est la Communauté européenne qui impose ses vues, sa volonté et sa stratégie de puissance ascendante, et non l’inverse.
Dans son petit ouvrage de 1992 sur « La Suisse et l’Espace économique européen », l’historien europhile Pierre du Bois raconte par le menu comment les délégués suisses à l’AELE, qui montaient au front en juin 1990 dans l’intention de négocier une plateforme optimale de coopération avec l’Union Européenne en préparation, se sont vus remis brutalement en place par la Communauté pendant dix-huit mois. « Le rêve d’association entre égaux vole en éclat. A son corps défendant, la Suisse est amenée à concéder des pans entiers de souveraineté. »
Les Suédois et les Finlandais comprennent la leçon et se soumettent aussitôt. Effrayés par le chaos qui a surgi à l’Est du continent, ils déposent leur demande d’adhésion comme les Autrichiens deux ans plus tôt. Les gouvernements suisse et norvégien aussi. Les citoyens suisses refuseront cependant de justesse le premier pas de l’EEE. Les Norvégiens le franchiront, mais repousseront l’adhésion en 1994 par référendum. La poursuite de leur intégration à partir de l’EEE semble attendre celle des Suisses dans leur voie bilatérale.
La bienveillance sans fin
Inutile aux yeux des soumissionnistes de vouloir résister à l’UE lorsque l’on est planté au milieu de sa géographie, avec une démographie de surcroît insignifiante. Selon l’expression consacrée dans ce genre de circonstance, Bruxelles tiendra toujours le couteau par le manche. La victoire canonique de David contre Goliath n’est qu’une grossière mystification. La loi du plus fort peut bien concéder quelques illusions morales et juridiques momentanées, mais elle finit toujours par s’imposer. Il s’agit peut-être d’une perception très pessimiste de l’histoire, légitimant toutes les lâchetés et compromissions, mais les pessimistes ne finissent-ils pas toujours par avoir raison ?
Cette dynamique mentale régressive est vieille comme le monde, et l’on se rend mieux compte aujourd’hui que le fond du monde a peu changé dans cette affaire. A une époque plaçant la véritable richesse des nations dans leur capacité à exporter des biens et services innovants à l’échelle globale, le levier du protectionnisme économique remplace la politique de la canonnière des anciens empires coloniaux. L’Union Européenne n’obtiendra-t-elle pas toujours ce qu’elle demande en échange d’un accès jugé privilégié à son grand et glorieux marché intérieur ? Avec la libre circulation et leur voie bilatérale, les Suisses se sont malencontreusement enfermés dans cette funeste spirale. Bien qu’ils ne soient plus seuls à s’en plaindre puisque les Britanniques cherchent aussi à en sortir.
 Tout le reste n’est que littérature
Tout le reste n’est que littérature
L’obstacle, ce sont les soummissionnistes. A leurs yeux, le seul moyen de mettre fin à l’insécurité juridique et à l’incertitude qui pèse sur l’industrie d’exportation et les multinationales, c’est d’accorder à l’UE ce qu’elle demande. Au fur et à mesure, sans que l’on voie très bien ce que l’UE pourrait encore demander que les organisations économiques oseraient refuser. Dire oui-oui pour préserver les exportations ? Pour ne pas contrarier Bruxelles inutilement ? Pour obtenir la paix et la stabilité ? Pour pouvoir en rester là ? C’était déjà ce que l’économie recommandait en 2000, lors du vote populaire sur les Accords bilatéraux I aux vertus pacifiantes desquelles tous les partis ont cru. Même l’UDC.
A une époque où l’objectif du Conseil fédéral était encore l’adhésion à l’Union Européenne, il s’agissait paradoxalement d’approuver ces accords pour pouvoir échapper à une adoption évolutive du droit européen. Et en rester là précisément. Et si l’UE en demande davantage par la suite ? « Nous serons libres d’accepter ou non ». Mais si nous ne nous montrons pas solidaires, « alors l’Union européenne pourrait commencer à nous faire payer cette attitude et à nous punir » (Peter Hasler le 3 mai dans L’Agefi, directeur du Vorort, futur economiesuisse). Voilà où en étaient déjà la voie bilatérale dans laquelle la Suisse et ses organisations économiques se sont fourvoyées.
Aujourd’hui, les soumissionnistes donnent toujours autant l’impression d’être prêts à donner ce que l’Union Européenne demande, au fur et à mesure, pour obtenir quelques mois ou quelques années de répit. Par peur des représailles, et pour continuer de bénéficier d’un dérisoire accès privilégié au grand marché européen. Ce privilège dont on finit évidemment par se demander ce qu’il a de si privilégié pour justifier de devoir subir de pareilles intimidations et mesures vexatoires sur la recherche, les études, les homologations industrielles, l’équivalence boursière, l’approfondissement de la libre circulation, les reprises automatiques du droit européen ou encore les services financiers…
Revue de presse commentée https://cutt.ly/ve5wzDI
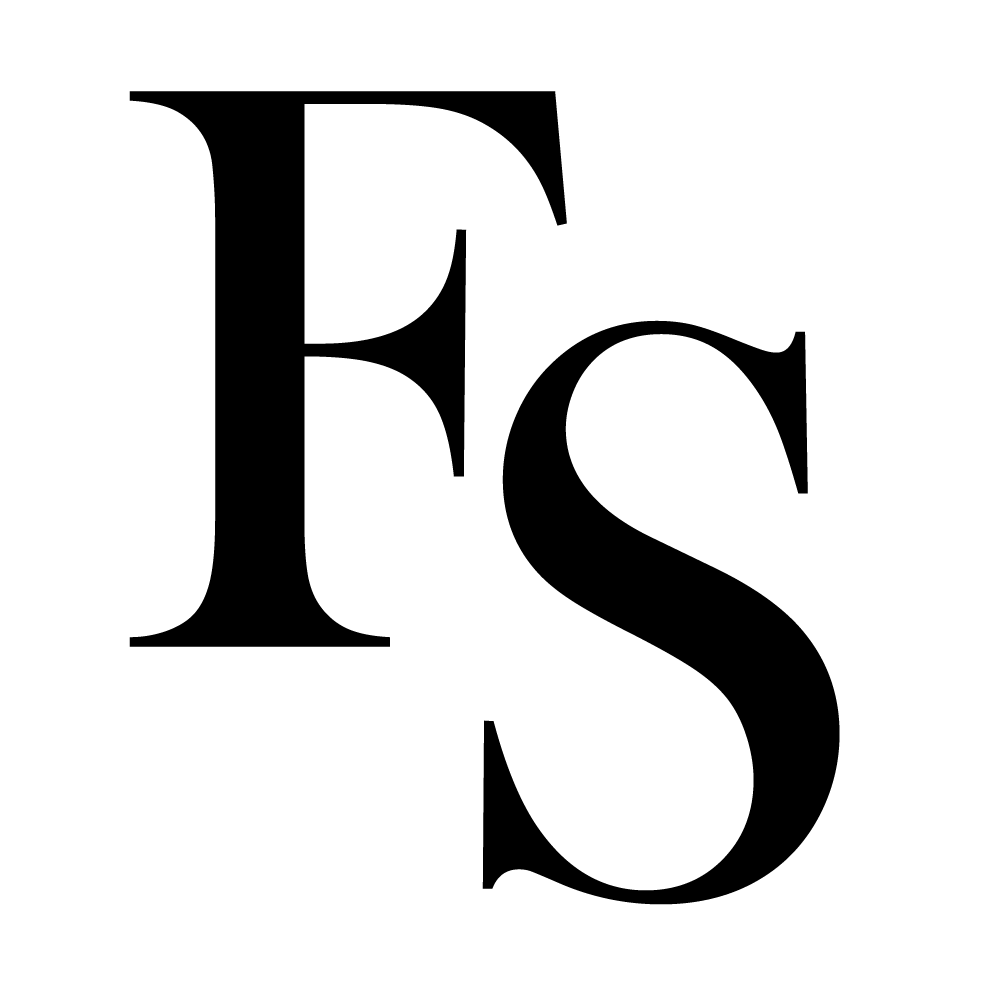


Nous n’avons pas besoin de nous prostituer comme le font actuellement nos autorités pour avoir accès au marché europèéen. Les accords du GATT, que nous avons contribué à éleborer, nous suffisent. Ce que les tyrans de l’Union Européenne font c’est du chantage pour l’accès au “marché unique”. C’est de la faute de nos négociateurs qui leur ont donné des verges pour nous fouetter en étant demandeurs là-dessus. Nous devons changer l’équipe au pouvoir.
Pour les diplomates comme Balzaretti, pas besoin de les changer. Ils ne font qu’obéir au gouvernement. Ce sont des exécutants et de bons professionels. Ce qu’il faut c’est un gouvernement qui ordonne aux Balzaretti & Co de dire à Bruxelles que notre but stratégique c’est de ne pas faire partie du marché unique à aucun prix et de rester un pays tiers.
Tant que le marché unique sera utilisé pour exercer un chantage politique sur le thème: l’accès au marché unique contre la capitulation sans condition de la souveraineté, nous n’avons pas le droit de mnener une autre politique que celle-là. Un état digne de ce nom ne cède pas au chantage.